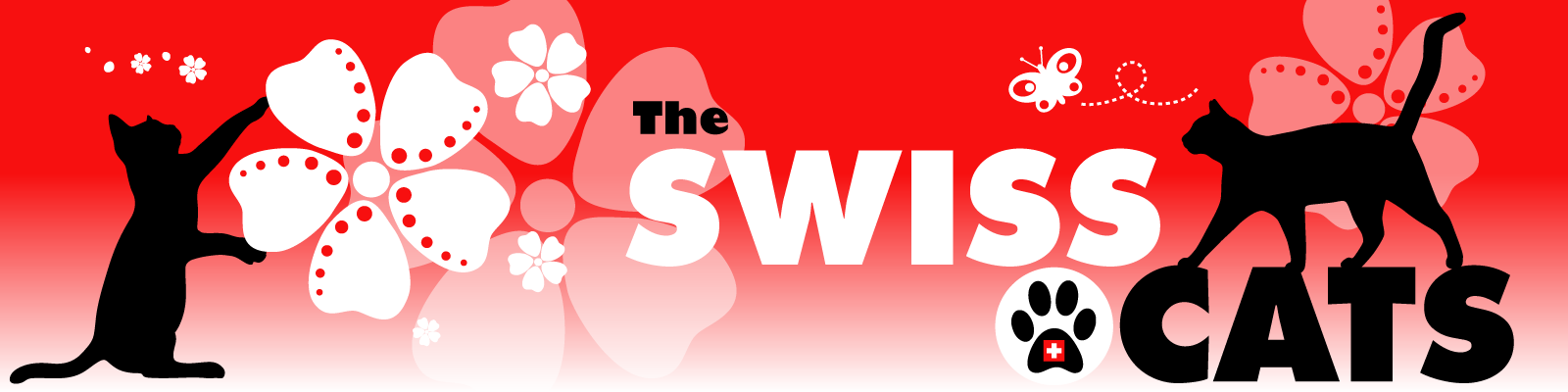Hier, Claire a malencontreusement marché sur une de mes pattes de devant. Le fait que je me tortillais parmi ses jambes n’a évidemment joué aucun rôle dans cet accident. Nous étions au jardin, et pour être honnête, je n’ai pas eu très mal, mais j’ai quand même hurlé un bon coup pour lui faire savoir qu’une telle maladresse était intolérable. J’ai ensuite vérifié qu’elle était bien inquiète et contrite, puis je suis allé faire une course-poursuite avec Pixie.

Savez-vous que jusque dans les années 80-90, on ne concevait pas que les animaux, ou les bébés humains, puissent ressentir la douleur au même titre que les humains adultes ?
Pourtant, différentes recherches montrent que la structure du système nerveux du chat est similaire à celle de l’homme, que les mêmes zones du cerveau sont activées en cas de douleur.
Qu’est-ce que la douleur ?
La douleur est une réponse sensorielle et/ou émotionnelle de l’organisme à une expérience le plus souvent désagréable. Elle a une fonction protectrice : elle vise à provoquer une réaction pour faire cesser ou éviter de renouveler l’expérience en question, ou s’y soustraire.
Quels sont les différents types de douleur que peut ressentir un chat ?
Douleur somatique ou douleur viscérale ?
La douleur somatique est précisément localisée au niveau de la peau, des muscles, des os, des articulations, ou encore des tissus conjonctifs. Elle est causée par un stimulus mécanique, chimique, ou thermique.
La douleur viscérale se situe au niveau des organes (thorax et abdomen) ; elle est difficile à localiser et diffuse. Par exemple, un chat ayant un problème de vessie pourra ressentir la douleur dans la peau de son ventre.
Douleur aigüe ou douleur chronique ?
Une douleur aigüe n’a souvent qu’une seule cause soudaine et brutale (coupure, brûlure, fracture, déchirure, …). Une opération chirurgicale est aussi une cause de douleur dite aigüe. Elle disparaît dès que l’organisme n’en a plus besoin pour se protéger. Une douleur aigüe est facilement soulagée par des traitements antidouleur.
Une douleur chronique est souvent le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs et d’une dérégulation des mécanismes de contrôle de la douleur : vous avez mal alors qu’il n’est pas ou plus normal d’avoir mal. Une douleur chronique est difficile à soulager ; elle répond souvent peu aux traitements antidouleur de base. Son traitement consistera en une combinaison de mesures : médicaments (antalgiques, anti-inflammatoires, antidépresseurs), prise en charge physique (chirurgie, physiothérapie, …), aménagements (matériel et environnement adaptés), et soutien psychologique.
La douleur procédurale
La douleur procédurale est la douleur que provoquent les soins prodigués au chat malade. Par exemple, mettre des gouttes dans une oreille en cas d’otite est extrêmement douloureux. Cette douleur peut conduire à des réactions agressives ou à des associations négatives (propriétaire = cause de la douleur).
Il convient donc d’identifier soigneusement les soins qui pourraient être douloureux afin de les prévenir (prise d’un antalgique avant le soin par exemple), et de choisir des techniques de soin les moins douloureuses possibles (contention du chat et manière de prodiguer le soin). Cette prise de conscience permet de mieux respecter votre chat, de limiter les association négatives, et d’avoir une meilleure sécurité pour le soignant.

Comment reconnaître la douleur chez votre chat ?
Contrairement aux humains, nous ne pouvons pas parler : seule une observation attentive permet d’évaluer notre douleur. Certains signes physiologiques et comportementaux peuvent être l’expression d’une douleur, par exemple :
– augmentation de la fréquence cardiaque
– pâleur des gencives ou des oreilles (vasoconstriction)
– respiration rapide et / ou superficielle
– perte d’appétit
– troubles digestifs (diarrhée ou constipation, vomissements)
– salivation excessive
– crispations, tremblements
– agressivité
– agitation, ou au contraire inactivité
– mise en retrait, ou au contraire recherche de câlins
– difficultés motrices (boiterie, difficulté à sauter ou à s’asseoir, …)
– grognements, gémissements, ou ronronnements
– visage crispé, yeux fixes ou vitreux, pupilles dilatées
– perte d’appétit
– toilette négligée
– élimination hors de la caisse (pipi ou crotte)
– protection ou léchage excessif d’une zone particulière
Comment traiter la douleur ?
Selon le type de douleur, son traitement nécessite une approche médicamenteuse « simple » ou une combinaison de différentes mesures, comme nous l’avons expliqué plus haut.
Seul un vétérinaire est habilité à choisir et si nécessaire combiner différents traitements pour une efficacité optimale. Dans tous les cas, il n’est pas question d’administrer à votre chat des médicaments prévus pour l’être humain !
Sources :
– Philippe Bocion, vétérinaire comportementaliste
– L.U. Sneddon, « Evolution of nociception in vertebrates: comparative analysis of lower vertebrates », Brain Research Reviews, vol. 46, 2004, p. 123–130
– Frances V. Abbott, Keith B.J. Franklin et Frederick R. Westbrook, « The formalin test: scoring properties of the first and second phases of the pain response in rats », Pain, vol. 60, no 1, janvier 1995, p. 91–102
– National Research Council (US) Committee on Recognition and Alleviation of Pain in Laboratory Animals, « Recognition and Alleviation of Pain in Laboratory Animals », National Center for Biotechnology Information, 2009